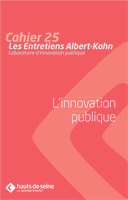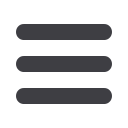
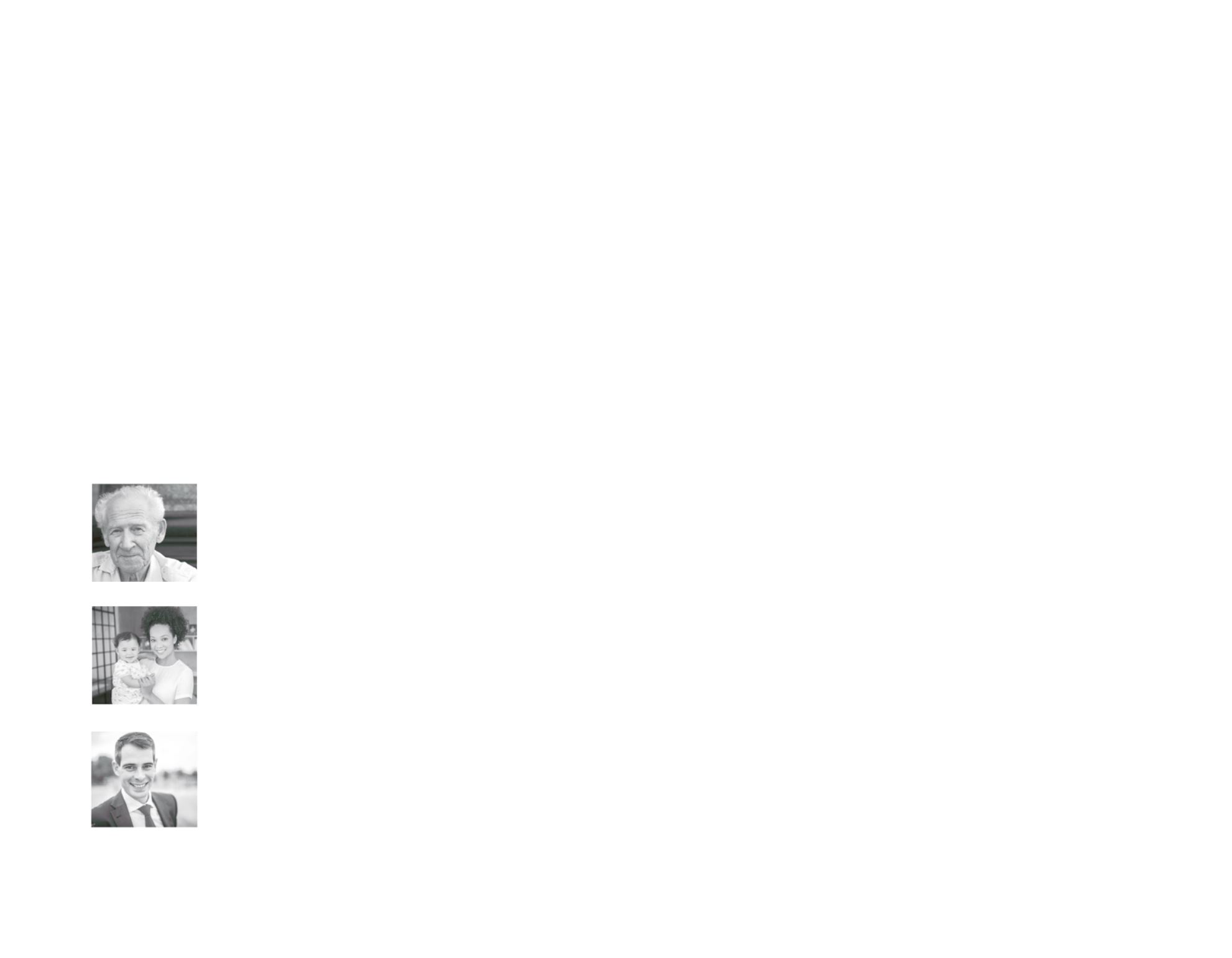
14
15
En se mettant dans les pas, voire dans la peau, de l’usager, certains
problèmes jusqu’ici peu visibles sautent aux yeux des agents, et des
postes de solutions apparaissent parfois très rapidement. Ce retour en
miroir sur le service public tel qu’il est réellement vécu par les usagers
est souvent un bon levier pour initier un changement parmi les agents,
qui voient d’un autre œil leur travail quotidien.
Un autre exemple d’outil est celui des «
persona
». Le « persona » est
une personne fictive stéréotypée, incarnant un profil d’utilisateur d’un
service ou d’un produit (caractérisé par son âge, son sexe, son métier…).
C’est un outil d’analyse et de représentation pour comprendre les usa-
gers des services publics à partir de leurs comportements, attentes et
besoins : il permet de susciter l’empathie, et de « faire entrer » l’usager
dans les réflexions des équipes travaillant sur un projet. Ainsi, en se
demandant si
Roger, 68 ans
, qui n’a pas Internet chez lui, que l’on voit
ci-dessous, va réussir à utiliser un nouveau service en ligne, la réflexion
devient souvent plus opérationnelle.
Les exemples ci-dessous ont été utilisés par le SGMAP pour un projet de
conception de démarches en ligne.
Roger, 68 ans, vit à Molières, à 23 km de Montauban. Il n’a pas
Internet chez lui. On lui a dérobé son portefeuille avec sa carte
nationale d’identité, son passeport et son permis de conduire.
Horya, 33 ans, divorcée, vit en Ardèche à la campagne. Elle
souhaite refaire son passeport et, pour la première fois, le
passeport de sa fille d’un an, avant son voyage en Tunisie
prévu dans quatre semaines.
John, Britannique de 35 ans, vit dans le Jura et ne parle pas
encore le français. Il souhaite déclarer sa nouvelle adresse en
France sur la carte grise de sa voiture achetée en 2011.
Des résultats concrets
Si l’usage de ces méthodes suscite en général un intérêt, et un entrain,
chez les agents publics qui en font l’expérience, elles produisent
également des résultats concrets. Ces résultats sont des services
publics, nouveaux ou améliorés, qu’ils soient numériques ou physiques.
Nous pouvons citer ici deux exemples de tels résultats.
Le site
impots.gouv.frillustre à ce titre deux méthodes innovantes,
utilisées par la Direction générale des finances publiques, avec l’appui
du SGMAP. Ce site a d’abord été conçu à partir de l’expérience des usa-
gers, d’une écoute approfondie des contribuables et de la diversité de
leurs usages, en particulier enmatière de déclaration des revenus. C’est
ensuite grâce aux enseignements de l’économie comportementale, et
des «
nudges
» pratiqués notamment au Royaume-Uni, que les mes-
sages incitant les usagers à la télédéclaration ont été conçus demanière
inédite, à l’aune des connaissances sur les mécanismes de décision du
cerveau humain. Ces deux leviers ont contribué à faire aujourd’hui de la
télédéclaration de l’impôt sur le revenu une réalité pour la majorité des
contribuables français.
Au sein de la Gendarmerie nationale, un processus d’innovation parti-
cipative permet depuis dix ans de faire connaître, primer et diffuser les
meilleures innovations créées par des gendarmes sur le terrain. C’est dans
ce cadre que plusieurs applications ont été déployées sur les téléphones
portables des gendarmes partout en France, comme « Tranquillité
vacances»pour optimiser les patrouilles selon la localisationdesmaisons
dont les occupants ont signalé leur absence.
L’innovation publique produit un autre type de résultats, tout aussi
important : de nouvelles compétences pour les agents publics. En
s’inscrivant dans ces démarches, en proposant des solutions, en s’appro-
priant de nouvelles méthodes pour mieux assurer leurs missions, un
nombre croissant d’agents publics apprennent à travailler autrement.
L’innovation publique contribue ainsi à enrichir le capital humain des
administrations.
Par exemple, dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir,
le SGMAP accompagne la création de douze « laboratoires d’innovation
territoriale ». Portées par les préfectures de région, souvent en par-
tenariat étroit avec des collectivités et d’autres organismes publics,
ces nouvelles structures sont autant d’espaces où des dizaines d’agents
publics vont se former, par l’action et la conduite de projets concrets, à
l’usage de nouvelles méthodes de travail.