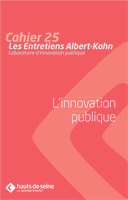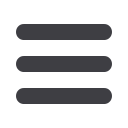

26
27
On observe enfin des modèles extrêmement différents avec
des rentabilités également très diverses. D’un côté, Airbnb et Uber
génèrent des revenus extrêmement importants ; de l’autre côté, des
petites associations locales ou des dispositifs fonctionnent au contraire
sur le don, sans même d’échanges monétaires. Tout type d’échelles,
tout type de modèles économiques. La question posée devant ce
foisonnement est au fond : comment les collectivités publiques et l’État,
qui travaillent sur l’attractivité de leur territoire, sur le développement
de l’accompagnement des dynamiques économiques de leur territoire,
peuvent-ils se positionner dans ce cadre?
L’accompagnement des dynamiques économiques,
le cas de la Ville de Paris
En France, peut-être avec notre tradition forte de service public, nous
sommes sensibilisés à ces notions de partage, de bien commun, de
mutualisation des ressources. Beaucoup d’entreprises se sont ainsi
développées dans ce secteur.
Quel rôle pour la collectivité ? En fonction du secteur, son positionne-
ment va être assez différent, avec toute une palette d’outils possibles.
D’abord, la collectivité peut être elle-même partenaire et acteur de
l’économie collaborative. La Ville de Paris a par exemplemis en place des
marchés et des partenariats public-privé pour financer ce partage de
service, comme avec Vélib’ et Auto lib’. Dans ce cas, la collectivité orga-
nise elle-même le partage de la ressource et permet son déploiement à
une échelle très importante. Autre exemple qui concerne la collecte de
textiles à Paris : nous avons fait le choix de n’avoir qu’un seul opérateur
à qui nous allons permettre le déploiement de containers dans tout Paris
pour assurer unmaillage du territoire. Rester dans dumicrolocal peut en
effet empêcher d’atteindre une échelle suffisante. Pour que le secteur
s’organise et puisse atteindre une échelle importante, la collectivité est
ainsi obligée de consacrer de l’espace : pour les Vélib’, il faut libérer de la
place pour les stations de vélo. Il en est de même pour les containers de
récolte du textile, pour Autolib’, etc.
Deuxième volet : la régulation. La presse en a abondamment parlé. Cette
nouvelle économie qui se développe peut échapper à toutes les règles,
même à celles du travail, à toutes les réglementations.
Avec Airbnb, au fond, chacun peut devenir un hôtel, sans pour autant
obéir à la même réglementation. Par ailleurs, se créent aussi des effets
d’aubaine, c’est-à-dire que, notamment dans le cadre du logement,
le risque était de voir Paris se vider complètement de ses habitants
et d’avoir uniquement des appartements utilisés pour la location
temporaire. Un certain nombre de villes, dont Paris, ont donc mis en
place une réglementation pour s’assurer qu’on restait bien dans le
cadre de l’économie collaborative et éviter qu’un business énorme se
crée avec de vrais acteurs économiques qui auraient dû suivre la même
réglementation que les hôtels. Dans notre cas, nous avons limité les
locations aux résidences principales, pour une durée de quatre mois
maximum. Par ailleurs, si vous voulez transformer votre logement pour
la location permanente, vous devez faire compensation, c’est-à-dire
que vous devez acheter des bons pour créer du logement ailleurs. Nous
considérons qu’il y a changement de destination de votre logement dès
que vous devenez une entreprise. Nous avons mis ainsi en place une
réglementation pour limiter les abus, pour que cette activité puisse se
développer en essayant d’en limiter les effets pervers. Nous ne sommes
d’ailleurs pas la seule ville à l’avoir fait. De nombreuses autres villes s’y
sont mises, y compris des villes qui ont pourtant la réputation d’être plus
libérales ou libertaires… Par exemple, à Berlin, c’est désormais interdit.
Barcelone a également adopté une législation beaucoup plus stricte que
nous. Il faut donc essayer d’encadrer cette nouvelle économie.
Troisième volet : le soutien au développement d’initiatives intéressantes
mais dont lemodèleéconomiquen’est pas complètement performant. Àla
VilledeParis,nousavonsmisenplace unplannotammentpour favoriser le
développement de l’économie circulaire. Par exemple, nous soutenons le
déploiement de ressourceries-recycleries : ce sont en effet des acteurs
qui ont beaucoup de mal à trouver un équilibre économique, surtout
dans Paris du fait du prix élevé de l’immobilier. La collectivité essaye de
les aider dans leur développement. Il y a aussi un travail engagé sur le
gaspillage alimentaire, pour essayer de le limiter, en organisant à la fois
des collectes au sortir des supermarchés et des cantines scolaires. C’est
de fait très compliqué à mettre en œuvre parce qu’évidemment, dès
qu’on parle de nourriture, il faut respecter un grand nombre de normes
d’hygiène, notamment si l’on redistribue ces aliments.
Ensuite, dans l’action, cela passe par des subventions, par le fait d’offrir
des locaux aux loyers modérés, d’essayer de développer des bonnes
pratiques. Mais les expériences restent quand même très locales et pas
forcément à l’échelle de notre territoire.
Un autre axe de travail important, c’est le changement d’échelle parce
que l’économie collaborative, c’est après tout de considérer chaque
Parisien, chaque citoyen comme un acteur économique par lui-même.