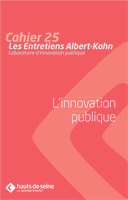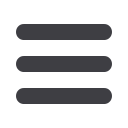
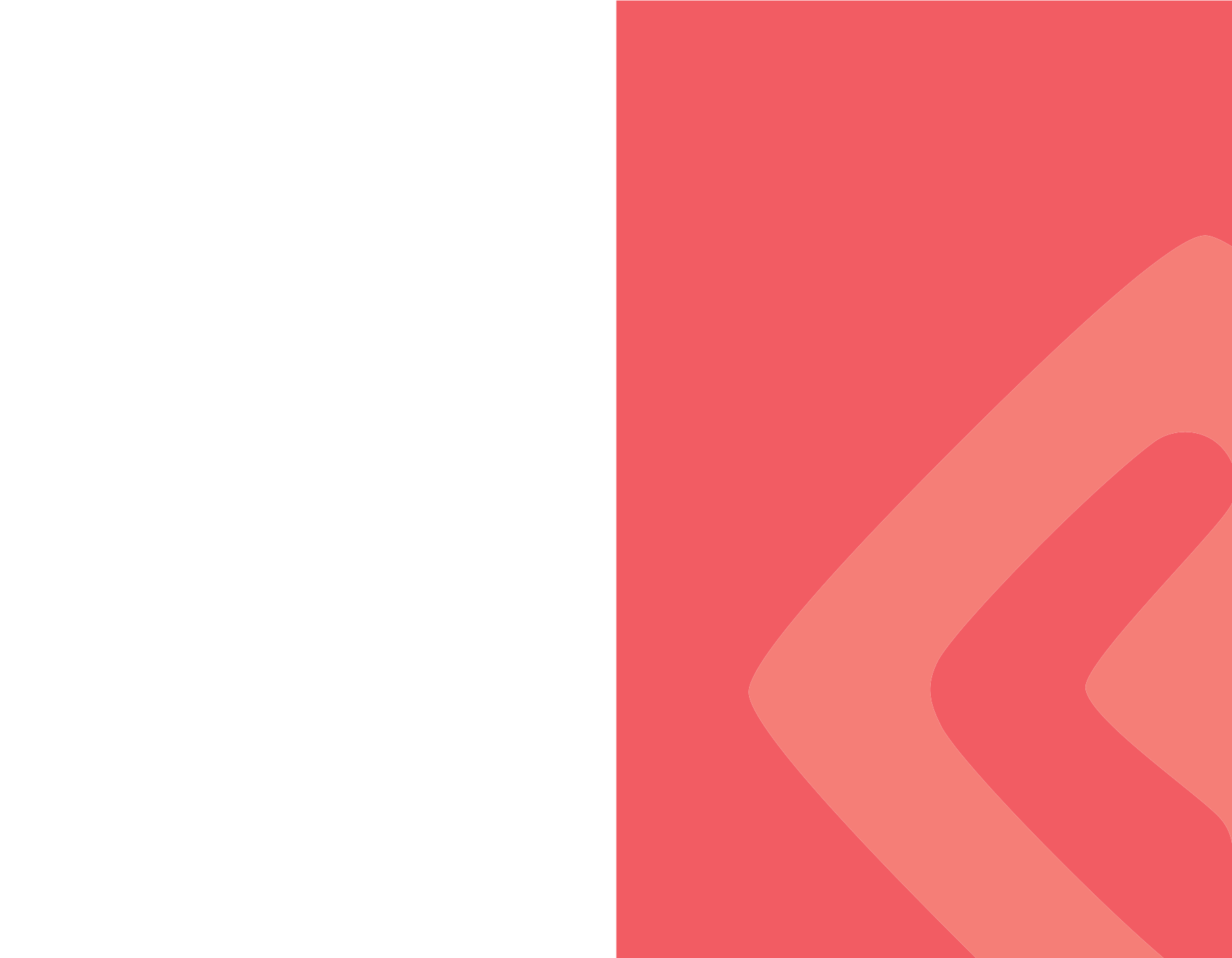
28
29
C’est-à-dire que moi, je peux aider un chômeur à retrouver du travail, je
peux aider au tri des déchets et en réduire ma production, ou je peux
consacrer une des chambres de mon appartement à l’accueil, etc. Tout
un tas de choses est possible si l’on fait évoluer ses pratiques. Ce qu’on
voit bien en effet, c’est qu’à partir d’un certain seuil, pour la collecte de
déchets par exemple, si l’on souhaite trier plus sans impliquer le citoyen,
sans en faire un acteur, alors dans ce cas, c’est la collectivité qui va devoir
tout trier. Et bien évidemment, payer pour ce tri en régie est quelque
chose d’extrêmement coûteux : et compte tenu du contexte actuel des
collectivités et des États en général qui ont beaucoup de mal à élever le
niveau d’impôts, ce n’est pas une situation viable.
La seule chose à faire si l’on veut progresser, c’est d’utiliser cette capacité
collaborative de tout un chacun, dans le cadre commun d’organismes de
fonctionnement notamment des villes et il y a énormément de secteurs
où c’est possible. L’emploi est une question, le social également. Par
exemple, on pourrait imaginer que chaque Parisien soit parrain d’un
nouvel arrivant. Il y a des millions de choses à développer et, là encore,
on est sur une forme de partage de notre temps, de nos savoirs, dans le
non monétaire. Cela fait aussi partie de l’économie collaborative.
La Ville de Paris cherche aussi à davantage impliquer le citoyen dans les
projets et politiques mis enœuvre par le biais du budget participatif qui
permet aux Parisiens de proposer des idées et de voter pour celles qui
leur paraissent les plus intéressantes : les projets retenus sont ensuite
étudiés et mis en place par la Ville. C’est ainsi 5 % du budget d’investis-
sement, soit près d’un demi-milliard d’euros, que Paris consacre à tous
ces projets portés par les citoyens eux-mêmes.
Pour conclure
, il me semble que pour penser le développement de
cette économie, dans laquelle il y a beaucoup de modèles différents
et qui touche à peu près tous les secteurs, nous devons vraiment nous
reposer la question de ce qui fait marcher notre société, cela interroge
notre contrat social. Il y a aussi du travail pour les universitaires et les
penseurs sur les conceptsemployés ! On voit d’un côté qu’il s’agit d’un
bien public qui est mutualisé, mais en même temps, le citoyen participe
aussi. Ce qui souligne aussi la limite de l’action publique.
Carine Saloff-Coste
Directrice de l’Attractivité et de l’Emploi
à la Ville de Paris
L’expérience du ThinkLab
de la Région Île-de-France
Véronique Volpe